- Marie-josé Taguet
- News
- 0 likes
- 121 views
- 0 comments
Centre National de Ressources textuelles et lexicales :
Ensemble, conscient ou inconscient, considéré dans sa totalité ou partiellement, des phénomènes, des processus relevant de l'esprit, de l'intelligence et de l'affectivité et constituant la vie psychique. Chacun de nous vit à la fois sur deux plans; sous le psychisme manifeste s'agite un psychisme latent, inconscient et réprimé (Mounier, Traité caract.,1946, p. 332).Les traces affectives laissées par des incidents psychiques deviennent inconscientes par refoulement, c'est-à-dire par un réflexe de défense qui lui-même peut appartenir à la couche non consciente du psychisme (Ricœur, Philos. volonté,1949, p. 360).V. désir ex. 2 :
L'évolution historique de la science humaine révèle de manière significative les liens étroits qui unissent le physique et le psychisme : l'homme est un tout et le sens de son activité ne pourra jamais être saisi que globalement. Hist. sc.,1957, p. 1543.
Larousse :
Le psychisme est la résultante d'un ensemble complexe de facteurs : satisfaction des besoins vitaux, humeur, émotions, structure affective, intelligence, capacités d'abstraction, activité pratique et créative. Cependant, les composantes du psychisme ne se limitent pas à la perception consciente : elles intègrent également les lois de l'inconscient, les impulsions instinctives, des facteurs génétiques et anatomophysiologiques (le fonctionnement cérébral étudié par les neurosciences).
Wikipédia :
1873 : le mot « psychisme » est dérivé de psyché, issu du grec ancien (« âme, souffle de vie ») avec le suffixe isme.
Le psychisme est l'ensemble des processus et phénomènes psychiques.
L’ensemble des caractères psychiques conscient ou inconscient, considéré en totalité ou partiellement, des phénomènes, des processus relevant de l’esprit, de l’intelligence, de l’affectivité et de la volonté constitue la vie psychique d'un individu.
Archive ouverte Hal : https://hal.science
Le psychisme humain d’après Patrick Juignet
Une entité abstraite
Du point de vue méthodologique nous considérerons le psychisme comme une entité théorique, un modèle construit à partir des comportements affectifs et relationnels des individus humains afin de les expliquer. Par modèle, on entend un système abstrait et simplifié qui permet des explications et des prévisions. En psychopathologie, la clinique permet d’établir des faits et la théorie cherche à en donner une explication rationnelle. Cette explication, peut se synthétiser en un modèle du psychisme souvent nommé la « structure psychique », car ce modèle forme un ensemble structuré.
Le plus probable, au vu des connaissances actuelles, est de considérer que cette entité est mixte car, pour expliquer les faits, il faut tenir copte à la fois de facteurs biologiques et du fonctionnement cognitif. C'est au sein du psychisme que l'énergie pulsionnelle d'origine biologique se transforme en processus qui généreront une partie de la pensée et des conduites humaines. De plus, par le biais des composants cognitifs, le psychisme intègre les influences sociales et culturelles (normes sociales, Loi commune, règles éducatives).
Prenons l'exemple d’un individu ayant des conduites relationnelles identiques et répétitives. Ceci doit nécessairement être inscrit et mémorisé chez cet individu pour expliquer la constance des conduites objectivement constatées, car il n'y a pas de génération spontanée des conduites humaines. Cette inscription, à laquelle on rapporte la détermination des conduites, peut être nommée un « schème relationnel ». Cela étant, il faut préciser cette idée : comment ce schème persiste-t-il ?
Deux hypothèses s’offrent : c’est soit sous une forme neurofonctionnelle, soit sous une forme cognitive et représentationnelle. En l’état actuel du savoir, il est difficile d'en juger. Une solution consiste à ne pas se prononcer sur sa nature. Cela veut dire que l'on propose un modèle, une théorie, sans se prononcer sur la nature exacte de son référent. Mais, on peut toutefois supposer qu'il existe.
Suite à ce préambule, nous pouvons donner les principes méthodologiques qui vont guider notre travail
visant à définir le psychisme :
- Il existe une entité complexe, repérable en chaque individu humain et elle génère les conduites, traits de caractère, types de relations, sentiments, symptômes, etc., décrits par la clinique.
- Cette entité évolue au fil de la vie individuelle et acquiert des contenus qui dépendent de facteurs
relationnels, éducatifs, sociaux, et de facteurs biologiques et neurophysiologiques.
- Il est possible de construire un modèle théorique, rationnel et cohérent, de cette entité à partir des faits cliniques. Ce modèle a d’abord une valeur opératoire, celle d’expliquer la clinique en intégrant les différentes influences qui agissent sur l’individu humain.
- L'entité comporte à la fois des aspects neurobiologiques et cognitivo-représentationnels qui ne sont pas toujours départageables. Elle intègre des influences relationnelles, culturelles et sociales, et enfin des facteurs biologiques. Ces facteurs sont pour certains communs, et pour d'autres singuliers, propres à chaque personne.
À partir de là, on comprend que le terme de « réalité psychique » est inadéquat. La réalité empirique est factuelle et le psychisme, qui est une entité supposée à partir des faits cliniques, ne se confond pas avec elle. La réalité étudiée est celle des faits mentaux et des faits comportementaux et l’on cherche à expliquer ce qui les génère en chaque personne.
La maturation du psychisme chez l’enfant.
Le bébé né avec une immaturité sur beaucoup de plans et notamment sur le plan psychique. Il est possible que le vie intra-utérine est permis la constitution d’une ébauche très simple du psychisme du fœtus. Pour continuer à faire croître et complexifier cette précieuse structure, l’enfant va devoir s’appuyer sur le psychisme de ses parents et des adultes qui gravitent autour de lui. Tout au long de l’enfance, ils transmettent des savoir-faire, des savoir-être, proposent des modèles de comportements qui vont s’intégrer à son psychisme. Quand une mère donne des soins corporels à son enfant pendant toutes les années de l’enfance, elle lui apprend en même temps à prendre soin de son corps (se laver, s’habiller, aller chez le médecin, se nourrir sainement….). L’objectif étant qu’au fur et à mesure il puisse prendre le relai et devenir autonome. Il peut alors se séparer de ses parents en sécurité. Là nous avons parlé des soins physiques. Il doit en être de même avec les soins psychiques. Quand une mère écoute sa fille qui pleure ou est en colère et l’aide à comprendre ce qui lui arrive tout en calmant la force de ses émotions elle lui offre un modèle qu’elle pourra utiliser seule une fois adulte pour s’apaiser et traverser les tumultes qui ne manqueront pas de bouleverser sa vie.
Pour résumer, on peut évoquer que l’adulte à intégré dans son psychisme des fonctions parentales indispensables pour pouvoir vivre dans le groupe social auquel il appartient. Elles sont issues de tous les contacts relationnels qu’il a eu avec toutes les personnes de son environnement (parents, enseignants, grands-parents, parrains, marraines, amis de la famille…)
La fonction maternelle sera plutôt dédiée aux soins du corps (afin de conserver une bonne santé) et du psychisme (calmer les pulsions, les émotions).
La fonction paternelle aura surtout pour rôle d’aider à quitter sa zone de confort afin de vivre des expériences nouvelles en sécurité.
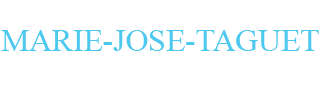
Comments (0)